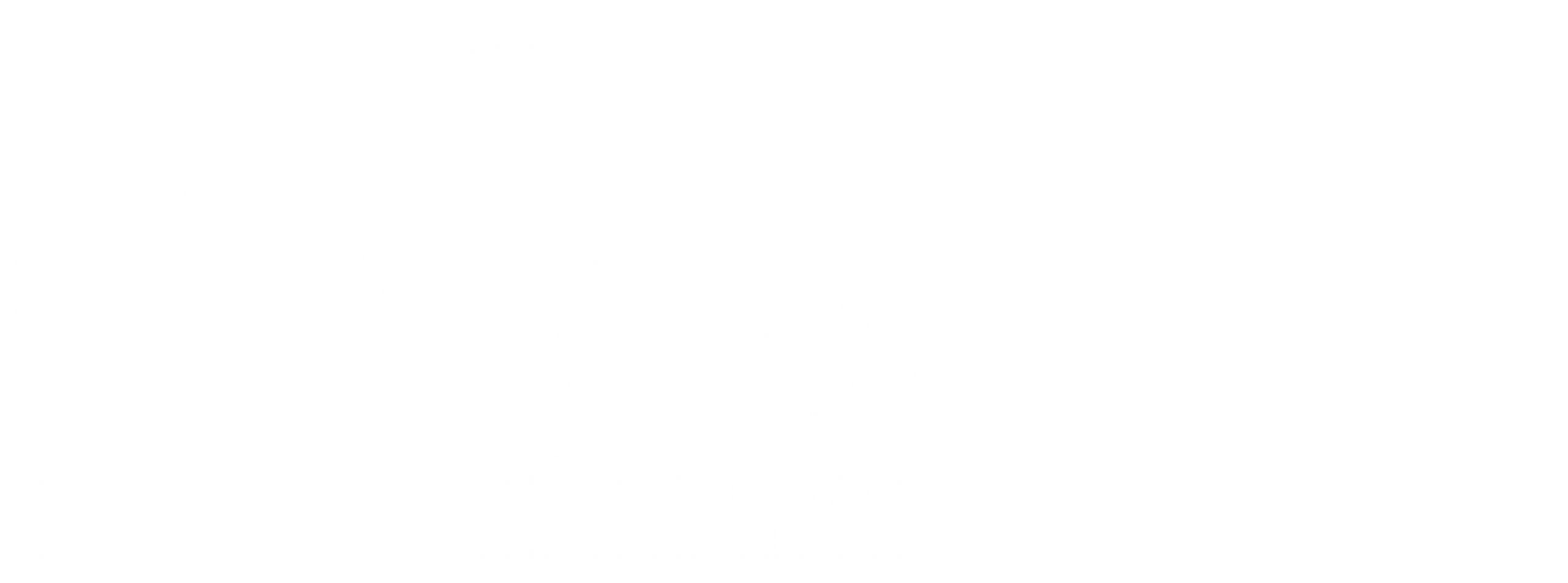L’affaire débute le 23 août 2022, au centre pénitentiaire de Châteaudun, situé en Eure-et-Loir. Ce jour-là, un détenu s’apprête à changer d’établissement, prenant la direction du centre de détention d’Orléans-Saran dans le Loiret. Comme c’est le processus habituel lors d’un transfert, ses effets personnels sont minutieusement listés par l’administration : vêtements, affaires de toilette, et, fait des plus inattendus, une console de jeux vidéo assortie de sa manette.
EN BREF
- Un détenu perd sa manette de console lors d’un transfert en prison.
- Le tribunal administratif d’Orléans condamne l’État à verser 200 euros d’indemnisation.
- Ce jugement souligne la responsabilité de l’administration pénitentiaire concernant les biens des détenus.
Cependant, à l’arrivée au nouvel établissement, l’inventaire ne correspond plus à la réalité. La manette a mystérieusement disparu, tandis que la console est endommagée ; son disque dur ne fonctionne plus. Pour le détenu, cette perte ne se limite pas à un simple objet, mais représente un investissement personnel. Ces biens, acquis avec ses fonds propres via le système de « cantine », ne lui ont pas été prêtés, mais ont été durement gagnés.
Les règles strictes du milieu pénitentiaire
Dans le milieu carcéral, posséder des biens comme une télévision, une radio ou une console de jeux n’est pas interdit mais est *très* encadré. Par exemple, les consoles de jeux ne bénéficient d’aucun accès à Internet, et chaque objet autorisé est inscrit sur un inventaire que l’administration gère. Cela signifie que les détenus doivent rendre ces biens dans leur état initial lors de chaque transfert ou libération.
Dans cette situation précise, lorsque le détenu réclame réparation pour la perte de sa manette et le dommage subi par sa console, l’administration refuse obstinément d’assumer sa responsabilité. Face à ce refus, l’homme décide de saisir la justice administrative. Un an plus tard, le tribunal administratif d’Orléans lui donne raison, comme le rapporte L’Écho républicain.
Une décision symbolique mais significative
Le jugement ordonne à l’État de verser 200 euros d’indemnisation, accompagnés d’intérêts. Bien que cette somme reste symbolique, elle est significative dans le contexte. Elle indique clairement que l’administration pénitentiaire doit être responsable des biens qui lui sont confiés et qu’elle ne peut se dérober à ses obligations.
Ce cas révèle non seulement les défis auxquels font face les détenus concernant leurs biens personnels, mais pose également des questions sur la gestion des établissements pénitentiaires. En effet, quelles mesures pourraient être mises en place pour éviter de telles situations à l’avenir ? Peut-être serait-il judicieux d’améliorer les protocoles liés à la gestion des effets personnels lors des transferts.
Ainsi, cette affaire met en lumière une problématique bien plus vaste, celle de la reconnaissance et du respect des droits des détenus, même dans un environnement aussi restrictif que celui de la prison. La décision du tribunal pourrait bien faire jurisprudence, rappelant à l’administration pénitentiaire l’importance de la diligence et de la responsabilité dans la conservations des biens des individus sous sa garde.