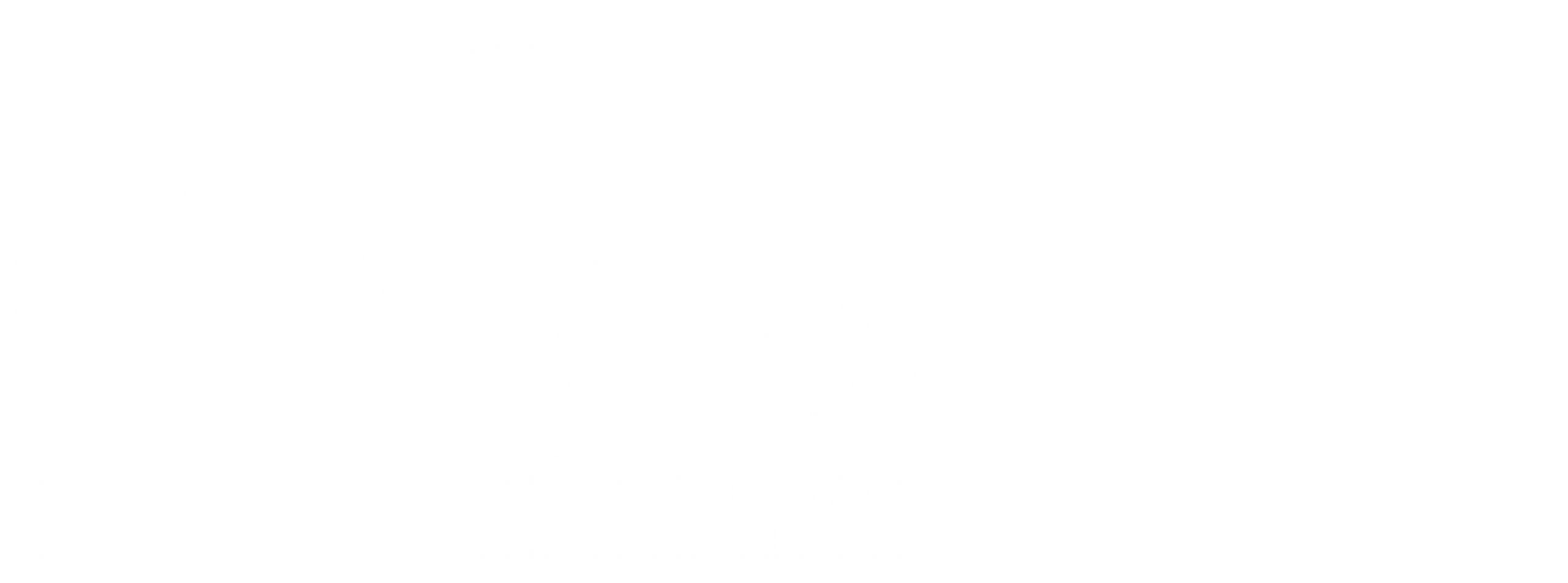«Serais très heureux de correspondre avec une charmante Française de 20 à 22 ans, brune ou blonde, mais sentimentale et sincère. Joindre photo si possible. Amicale pensée à ma future correspondante», écrivait, sous pseudonyme, « L’aventure d’Éric » en 1934, dans Le Courrier de la midinette, ancêtre de l’application Tinder. Dans les archives de ce journal illustré, visibles à l’exposition « Les gens de Paris » au musée Carnavalet, on découvre des annonces de célibataires décidés à trouver l’amour.
EN BREF
- Paris, une ville marquée par la solitude des célibataires.
- Les chiffres montrent un déséquilibre entre le nombre de célibataires et le taux de natalité.
- Une exposition au musée Carnavalet explore ces notions d’amour et de démographie.
Paris est souvent décrite comme la ville des célibataires. En effet, Valérie Guillaume, directrice du musée Carnavalet-Histoire de Paris, souligne ce paradoxe : “Si Paris a pour réputation d’être la ‘ville de l’amour’, c’est peut-être parce que les célibataires y sont particulièrement nombreux”. Entre 1926 et 1936, la population potentiellement en âge de se marier et qui ne l’était pas encore représentait 29 % des Parisiens et Parisiennes de plus de 15 ans, un chiffre remarquable comparé à celui du reste du pays.
Entre frivolité et dynamiques démographiques
À Paris, les histoires d’amour se multiplient, mais souvent sans lendemain. « J’ai deux amours, mon pays et Paris », chantait Joséphine Baker, célébrant ainsi le charme éphémère de la capitale. Cette ville offre une multitude d’opportunités pour les rencontres, comme en témoignent l’essor des petites annonces matrimoniales, ainsi que les nombreux bals et dancings. Les lieux de sociabilité abondent.
Au fil de l’exposition au musée Carnavalet, un contraste saisissant se dessine : d’un côté, des récits de relations éphémères et de jeunes femmes célibataires, appelées catherinettes, qui savourent leur liberté, et de l’autre, des affiches gouvernementales exhortant les couples à faire des enfants. Ce clash entre la célébration de la vie amoureuse et l’appel au devoir de reproduction reflète une double dynamique sociale complexe.
«Il faut faire naître»
Ce paradoxe d’un Paris rempli de célibataires s’accompagne d’une préoccupation croissante pour la natalité. À cette époque, le déclin de la natalité suscite une inquiétude chez certains gouvernants et associations. “Il faut faire naître”, affirme l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population en 1924, inscrivant les enfants comme un impératif national. La réalité était que près de la moitié des couples mariés à Paris vivaient sans enfants.
Entre 1926 et 1936, l’indice de fécondité à Paris était très faible, avec 1,6 enfant par femme, et la situation n’a fait que se détériorer. Ce phénomène était exacerbé par l’éloignement des enfants, souvent placés chez des nourrices en périphérie. Le gouvernement encourageait à avoir plus d’enfants, allant jusqu’à promettre des récompenses aux familles nombreuses, à travers des prix comme le prix Cognacq-Jay, décernés à celles ayant au moins neuf enfants du même lit.
Ces volontés pro-natalistes s’illustraient avec l’affichage massif de slogans et de lois restrictives concernant la contraception et l’avortement. À la suite de la loi du 31 juillet 1920, les sanctions relatives à l’avortement se sont durcies, témoignant d’une volonté d’encadrer très strictement la question de la maternité.
La situation des familles nombreuses, bien qu’érigée en exemple, restait exceptionnelle à Paris. La famille Guillemin, photographiée par le musée, était une rare illustration de cette norme valorisée, dans un cadre urbain où les familles nombreuses semblaient peu nombreuses. Valérie Guillaume décrit cela comme une réalité contrastée et fascinante de l’époque.
Exposition « Les gens de Paris, 1926-1936 », au musée Carnavalet-Histoire de Paris, jusqu’au 8 février 2026.
Cette exposition soulève ainsi des réflexions sur le rapport complexe entre les relations amoureuses, la structure familiale et les dynamiques sociales à Paris au cours des décennies passées. Au-delà des façades romantiques, elle propose une plongée dans l’histoire de la vie urbaine et de ses défis.