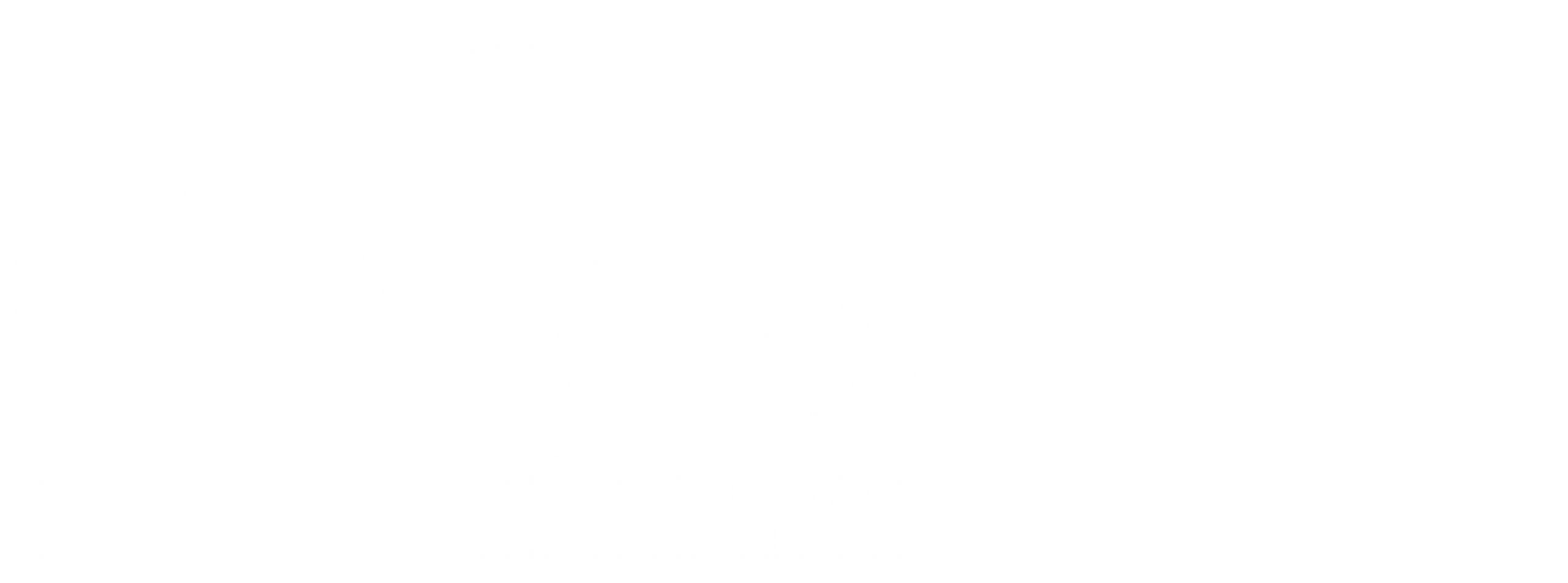Ce 12 octobre, Andry Rajoelina, 51 ans, a quitté Madagascar de manière inattendue. Ancien président de la Haute Autorité de la transition entre 2009 et 2013 et chef de l’État élu en 2018, sa sortie du pays évoque des réminiscences des coups d’État qui ont marqué l’Afrique dans les années 1970. Pourtant, cet exil ne signifie pas nécessairement une défaite pour Rajoelina, qui ne s’est pas vu contraint à une démission publique. Avec la transition politique engagée, le colonel Michaël Randrianirina prend les rênes du pays, le temps d’une période incertaine.
EN BREF
- Andry Rajoelina exfiltré de Madagascar suite à des émeutes à Antananarivo.
- Michaël Randrianirina devient l’homme fort du pays durant la transition.
- Les tensions politiques mettent en lumière les défis de la gouvernance à Madagascar.
Les événements qui se sont déroulés à Antananarivo depuis le 25 septembre furent marqués par des mécontentements croissants, exacerbés par des délestages d’électricité et des manques d’eau chronique. Ces dysfonctionnements ont galvanisé le mouvement « Gen Z Madagascar », qui a su utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser de nombreux citoyens en quête de changement. Andry Rajoelina, bien qu’ayant tenté de reprendre le contrôle en nommant le général Ruphin Fortunat Zafisambo comme Premier ministre le 6 octobre, a dû faire face à une fronde de certaines factions de l’armée qui, le 11 octobre, ont choisi de soutenir les manifestants. Le climat d’anxiété et de révolte était palpable, culminant avec l’exil de cet homme politique emblématique.
À Madagascar, il est notoire que les mandats présidentiels se terminent souvent dans une ambiance chaotique. Des acteurs divers tels que des mouvements populaires, l’armée et des institutions religieuses interviennent souvent dans les crises politiques. Ce constat rappelle la chute de l’amiral Didier Ratsiraka en 2002, dont la résistance acharnée face à des contestations électorales a finalement mené à un départ précipité du pouvoir.
La situation actuelle illustre bien les fragilités des gouvernances sur l’île. L’annonce du pouvoir malgache dénonçant une « tentative de prise de pouvoir illégale et forcée » a été rapidement suivie d’un appel à la communauté internationale. L’Union africaine, exprimant sa préoccupation face à l’instabilité, a suspendu Madagascar de ses instances le 15 octobre. Ce retrait met en évidence les enjeux de légitimité en Afrique, où les tensions entre la légitimité électorale et la légitimité populaire suscitent des débats sans fin.
Un contexte de défi
Depuis deux décennies, la communauté internationale a souvent été appelée à intervenir dans les crises malgaches, mais peu de progrès tangibles ont été réalisés. Les solutions apportées lors des sommets internationaux, à l’instar de ceux qui se sont tenus à Dakar ou Maputo, n’ont pas réussi à résoudre les problèmes structurels qui rongent le pays. D’après un expert électoral ayant travaillé intensément sur le sujet, la corruption et la pauvreté restent omniprésentes, tandis que les élections sont scrutées avec une attention particulière mais ne débouchent que sur des résultats controversés.
En observant le cas malgache, il est légitime de se demander si les méthodes traditionnelles d’intervention ne montrent pas leurs limites. Les expériences passées révèlent une répétition des schémas de troubles lorsque les élections n’aboutissent pas à une gouvernance acceptable et respectueuse des aspirations populaires.
Il semble peu probable qu’Andry Rajoelina, même depuis l’étranger, puisse galvaniser une opposition significative. La transition actuelle est source d’incertitude et pourrait prolonger la crise. Unissons nos regards vers cette île malgache, dont l’histoire politique rappelle à tous la complexité des enjeux de pouvoir et les luttes pour la légitimité, dans un contexte où les espoirs d’un nouvel avenir demeurent fragiles.
Ceux qui ont observé les défis politiques à Madagascar peuvent faire le constat amer qu’à chaque crise, le pays semble se retrouver au même point de départ, avec l’espoir de changement souvent obscurci par les réalités de la mauvaise gouvernance.